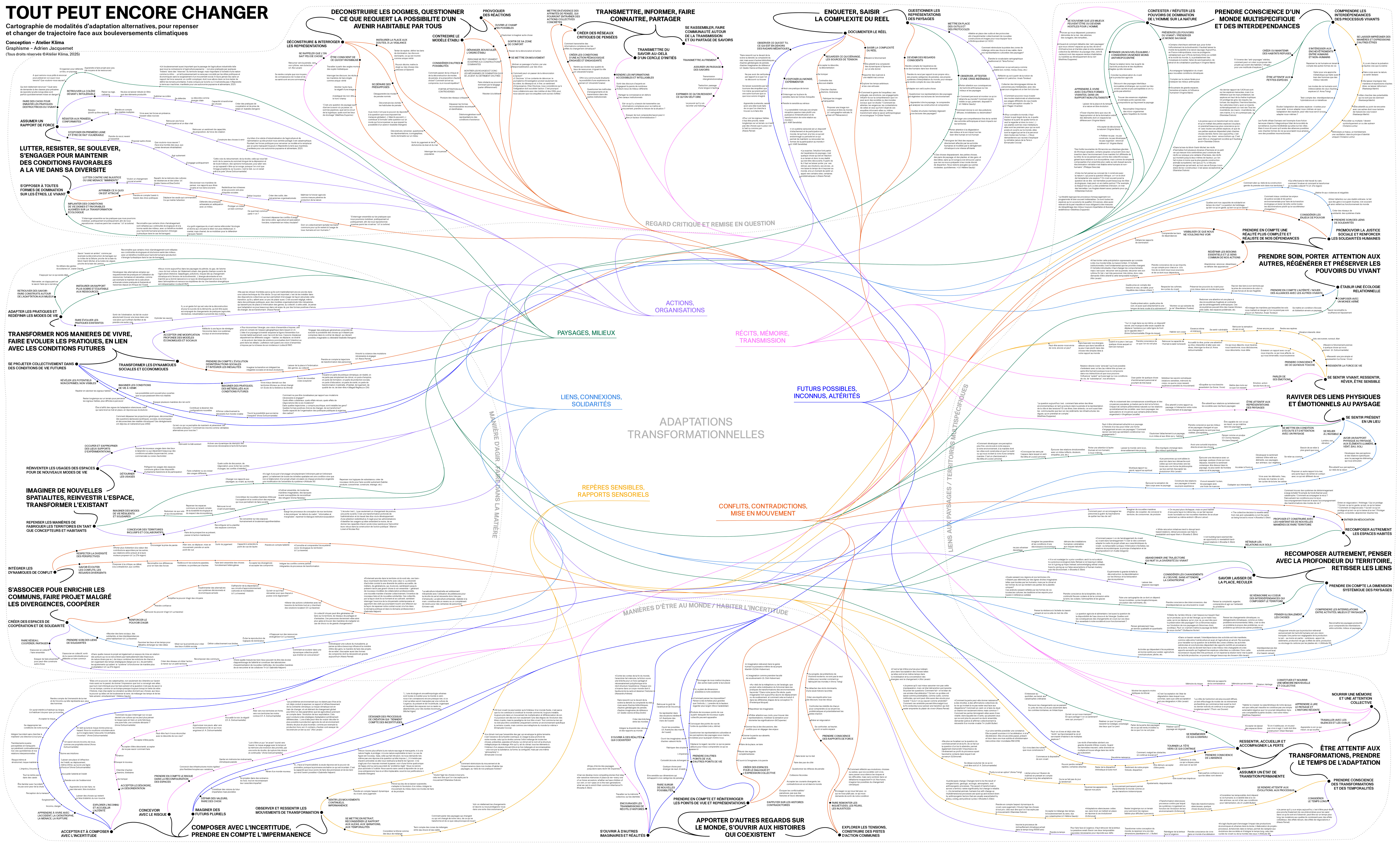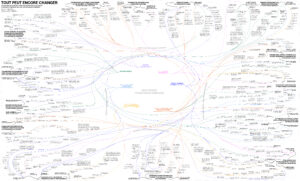Atelier Klima
 Menu
Menu

Cette cartographie intitulée “Tout peut encore changer” a pour objectif de repenser l’adaptation, en faisant le pari d’un changement radical dans nos modes de pensée et d’action. A travers cette carte, nous cherchons à repérer ce qui existe à bas bruit, ce qui émerge, et qui ouvre la voie à des imaginaires nouveaux. Elle met en lumière des modalités d’action spécifiques, qui selon nous sont susceptibles de transformer nos trajectoires et d’opérer un véritable changement.
Cette cartographie a été pensée dans la continuité de nos réflexions sur l’adaptation menées au moment de la constitution de l’Atlas Loire Bretagne (présenté également sur ce site). Dans cet Atlas, nous avons cherché à illustrer d’autres marqueurs de l’adaptation en repérant des initiatives singulières sur notre périmètre d’enquête. Ce sont des approches que nous avons considérées comme évolutives et transformatives, qui témoignent de changements sociétaux structurels (spatiaux, organisationnels, etc.) et/ou de changements ontologiques (culturels, conceptuels, manières de penser ou d’être au monde, etc.). Nous avons ainsi présenté et analysé un corpus d’une centaine d’initiatives, puis nous les avons classées selon des “Modalités d’adaptation”, définies comme des manières distinctes de répondre aux changements climatiques.
C’est à partir de cette matière que nous avons conçu cette carte mentale afin de définir, conceptualiser et détailler chacune des ces modalités. Nous voulions ainsi élargir le cadre de réflexion de ce qui est perçu comme de l’adaptation. Les 15 modalités sont positionnées en périphérie de la carte, telles que “Déconstruire les dogmes, questionner ce que requiert la possibilité d’un avenir habitable par tous” ou “Lutter, résister, s’engager pour maintenir des conditions favorables à la vie dans sa diversité”, ou encore “Recomposer autrement, penser avec la profondeur du territoire, retisser les liens”, etc.
Chaque modalité est ensuite détaillée sous forme d’arborescences, présentant des associations d’idées. Ces arborescences créent plusieurs pistes à suivre et ouvrent de nouveaux paysages de réflexion. Ces lignes de mots ont été construites à partir de plusieurs éléments de notre travail d’enquête : des analyses des projets sélectionnés, des interviews des porteurs de projets, des citations extraites de lectures en lien avec chaque thématique, ainsi que nos propres propositions. Chaque arborescence est structurée en plusieurs niveaux de lecture (titres, sous-titres, texte) selon le degré de détail que l’on y associe.
Les fils de couleurs reliant les différentes modalités représentent des thématiques récurrentes, regroupées au centre de la carte comme des chantiers à explorer : “Futurs possibles, inconnus, altérités”, “Liens, connexions, solidarités”, “Repères sensibles, rapports sensoriels”, etc. Les modalités sont également classées en quatre pôles, dont les intitulés apparaissent au centre en gris : “Regard critique et remise en question”, “Liens aux paysages / territoires multispécifiques”, “Manières d’agir / Faire dans la matière”, ou encore “Manières d’être au monde / Habiter l’incertitude”. Ces pôles constituent une autre manière de regrouper les modalités, en explicitant d’autres points de convergence.
Nous considérons ces modalités comme un ensemble indissociable, sans hiérarchie interne, ni sens de lecture. Cette composition dessine, selon nous, une représentation de l’adaptation transformationnelle.
Ce travail de cartographie a été réalisé sur quatre années, il a traversé plusieurs étapes, et versions successives (que vous pouvez explorer en cliquant sur l’onglet à droite “Aperçu des différentes versions”). Il représente une pensée critique à un moment donné, née d’un processus vivant d’accumulation d’idées. Bien que nous présentions ici la version la plus récente, cette carte pourra toujours être modifiée et enrichie à mesure que le temps et les événements font évoluer les enjeux.
Nota : Cette recherche, bien que fondée sur un ensemble d’initiatives concrètes, n’est pas exhaustive et pourrait être continuellement enrichie. Elle reste aussi subjective, vue et pensée à travers notre propre regard et nos choix de sélection. Ce document n’a pas pour vocation de figer une pensée ou de la présenter comme “ juste” ou “universelle”, mais plutôt de stimuler la réflexion critique, d’ouvrir les débats, de poser des questions et d’offrir d’autres perspectives. Ce travail représente une analyse issue d’un contexte culturel occidental, en France et réalisée entre 2020 et 2024.
Création et réalisation : Marie Banâtre et Sophie Dulau. Collaborations ponctuelles : Luce Renaud et Elsa Attlan. Collaboration graphique : Adrien Jacquemet. Tous droits réservés ©Atelier Klima, 2025.