Atelier Klima
 Menu
Menu
Nous avons retrouvé Alix Levain dans sa maison à Rosnoën, en fond de la rade de Brest. Elle est docteure en anthropologie sociale au CNRS et travaille au sein du laboratoire Aménagement des usages, des ressources, des écosystèmes marins et littoraux à Brest. Nous voulions en savoir plus sur son projet de recherche Parchemins, nous avons parlé ensemble des spécificités de l’agriculture littorale, de paroles d’agriculteurs, de perceptions du changement, de l’évolution des milieux, de conflits d’usages et des liens entre la mer et les bassins-versants.
Entretien réalisé par Klima (Sophie et Marie), le 25 septembre 2020.
Klima : Bonjour Alix, merci de nous accueillir chez toi à Rosnoën. Alors une première question pour se mettre dans le bain, nous aimerions savoir à quel rivage te sens-tu attachée, reliée ?
AL : J’habite au bord de la mer et plus précisément dans un estuaire. Je me sens très attachée aux estuaires, y compris physiquement, parce que lorsque je suis dedans, j’ai du mal à décoller mes bottes ! Ensuite, par les enquêtes que l’on fait quand on est ethnologue, on est amené à fréquenter une grande diversité de milieux et quelque part, l’attachement que l’on développe auprès des personnes que l’on interroge et avec lesquelles on vit quelques jours ou quelques mois, rendent ce milieu le nôtre. Je suis donc devenue apatride de ce point de vue-là, et assez attachée au littoral de manière générale.
Klima : Tu es chercheuse en anthropologie, peux-tu nous expliquer la spécificité de ta recherche en tant qu’anthropologue ?
AL : Je cherche à rendre compte de l’expérience de vie des humains dans leur diversité par des enquêtes très approfondies, où j’essaye de partager cette expérience-là au quotidien, pendant un temps assez long. Suivant l’enquête, je m’installe quelque part et j’essaye d’appartenir à un territoire, à une communauté plus ou moins large pour rendre intelligible, avec les mots justes, cette expérience de vie auprès du plus grand nombre. C’est une expérience pour le chercheur de prise de recul par rapport à son propre vécu, ses propres catégories de pensées, ses propres systèmes d’interprétation du monde, pour essayer de rendre compte de ceux des autres. C’est un beau métier qui ne laisse pas indemne et qui, je pense pour nous tous ethnologues et anthropologues, fait que l’on vit toujours à cheval sur deux mondes.
Klima : Comment en es-tu venu à choisir ce métier ?
AL : Je n’ai pas fait ça toute ma vie. Auparavant, je travaillais ici, dans le Finistère, dans le domaine de l’action publique au sein de collectivités territoriales. Et au bout de quelques années dans ce travail qui était très opérationnel, je suis partie me former au Muséum d’Histoire Naturelle, à ce qu’on appelle l’ethno-écologie, c’est-à-dire l’étude du rapport à l’environnement des sociétés dans leur diversité. Ça a été ma formation en anthropologie. J’étais partie pour un an et je ne me suis plus jamais arrêtée.
Klima : Tu as fait partie du programme de recherche Parchemins sur l’agriculture littorale en Bretagne, peux-tu nous le présenter ?
AL : Le projet Parchemins, ou Par les Chemins de l’Agriculture Littorale, réunit des chercheurs d’horizons très variés, du géomaticien, au spécialiste de l’information géographique, jusqu’à l’ethnologue. L’enjeu de ce projet est de rendre compte des trajectoires et de l’expérience de vie des personnes qui s’intéressent à l’agriculture sur les territoires littoraux en Bretagne, et, en premier lieu, des agriculteurs et des agricultrices eux-mêmes.
Partant du principe que la liaison entre l’agriculture et le littoral est aujourd’hui problématique, car l’agriculture sur les territoires littoraux est plutôt interpellée par ses impacts négatifs sur les milieux, et moins par sa contribution à la transition agro-écologique, ou par sa contribution à la qualité de vie sur le territoire. Ayant chacun déjà travaillé avec les agriculteurs sur ces territoires-là, nous voulions déplacer notre regard afin de comprendre comment l’agriculture s’inscrivait dans ces territoires ? Comment ça s’est transformé au cours du temps et qu’est-ce qu’on peut en dire aujourd’hui ?
Nous voulions le faire à partir de la parole des acteurs, pour nous, c’était très important et c’est pourquoi on a lancé le programme Parchemins. Il s’agissait de trouver les voies et moyens de rendre cette parole audible, sachant qu’évidemment, on a tous nos idées préconçues sur ce qu’est l’agriculture en Bretagne. Elle est le symbole du productivisme et notamment de l’élevage intensif. Nous cherchions à comprendre comment ces activités, tournées vers l’exportation massive de gros volumes de production, peuvent s’ancrer sur ces territoires-là ? C’est l’un des sujets sur lesquels nous travaillons depuis trois ans.
Klima : Peux-tu nous donner un exemple de démarche que vous avez initiée dans le cadre de votre travail de recherche ?
AL : Le travail que je fais avec Radio Évasion pourrait être un bon exemple. Nous avons produit des émissions radiophoniques qui donnent la parole à des agriculteurs pour rendre compte des transformations qu’ils ont vécues sur le territoire. Et ça se poursuit aujourd’hui par un partenariat avec un établissement public de coopération intercommunal local, avec lequel on essaye de faire le lien entre l’engagement des agriculteurs dans les programmes de lutte contre la pollution et les outils que nous mobilisons, comme le récit de vie, pour rendre intelligible et accessible le sens que les agriculteurs donnent à leurs actions dans ce type de contexte.
Klima : Quelles sont les particularités de l’agriculture littorale bretonne et des agriculteurs qui la portent ?
AL : « L’agriculture littorale » est une notion peu utilisée, car l’image dominante de l’agriculture à l’échelle bretonne est celle d’une agriculture très homogène. On pense qu’il y a un modèle agricole breton qui, comme un rouleau compresseur, a tout ravagé sur son passage et qu’il y a essentiellement de la production de masse, hors-sol, caractérisée par de forts apports d’intrants, de produits phytosanitaires, d’engrais et d’effluents, pour qu’ensuite la production soit exportée. Cela correspond à un mouvement très fort de modernisation de l’agriculture en Bretagne qui est l’une des réalités, mais pas l’unique.
C’est, en effet, le modèle qui s’est imposé de façon dominante dans les années 1960/70 avec le soutien des pouvoirs publics. Par exemple, on sait qu’en Bretagne, on est aujourd’hui la première région d’élevage français, avec une surface agricole utile qui est relativement limitée. On accueille parfois jusqu’à 50 % des volumes de production française en viande, notamment en viande porcine, en production de viande bovine, mais surtout de lait et de volailles.
À côté de ça, il y a une très forte production légumière localisée, si on regarde une carte de production agricole en Bretagne, on va s’apercevoir que la production légumière est concentrée sur le littoral. Car historiquement, c’est sur le littoral qu’il y avait les conditions pédoclimatique (sols riches, absence de gel qui va avec la proximité de la mer…) qui permettaient des agricultures spécifiques. Alors, évidemment, la production légumière dominante telle qu’elle se fait aujourd’hui, s’est largement affranchie de ces contraintes pédoclimatiques puisque c’est devenu une production industrielle avec de la sélection variétale qui permet de s’affranchir de tout ça, mais néanmoins elle est restée là.
Mais on a aussi sur le littoral des éléments de diversification, plus récents. On peut retrouver des petites parcelles, souvent incluses dans des hameaux, qui au départ étaient des fermes et qui ont changé de vocation. Il y a donc un entremêlement de terres agricoles de petites tailles et d’un bâti occupé par des nouveaux arrivants (retraités, maisons de vacances). La taille même de ces petites parcelles, empêche la pratique d’une agriculture intensive, on observe donc un mouvement de repli de l’agriculture conventionnelle vers l’intérieur des terres, au profit de petites unités agricoles qui suivent d’autres modèles de production. Par exemple, la production maraîchère, généralement en agriculture biologique, sur de petites unités de 1, 2, 3 hectares qu’on retrouve justement sur ces territoires littoraux.
Donc on a une agriculture beaucoup plus diversifiée sur le littoral qu’à l’échelle régionale, avec à la fois une agriculture traditionnelle et conventionnelle et de nouvelles formes d’agriculture qui se développent davantage sur le littoral qu’à l’intérieur des terres.
Klima : Quelle est la part de l’agriculture bretonne produite pour l’exportation ?
AL : On est sur des échelles de production qui excèdent, de façon massive, les besoins alimentaires du territoire. C’est ce qu’il faut retenir, notamment sur les productions animales. Je peux vous donner quelques petits indices, par exemple, je discutais il y a quelques années, avec un couple d’agriculteurs et éleveurs laitier, ils avaient calculé que la production en lait d’une seule commune des Côtes d’Armor suffisait à rendre autonome en lait l’ensemble du département des Côtes d’Armor. Ça vous donne une idée, de ce que ça veut dire que d’être dans un territoire qui fait de la production à destination de l’exportation.
Une autre petite vignette que je peux partager, c’est l’une des enquêtes que je fais actuellement sur le mouvement des gilets jaunes et qui suit une autre étude que j’avais faite en 2013 où j’avais suivi le mouvement des bonnets rouges. Ils avaient notamment le projet fou d’affamer Paris, leur idée était qu’avec un barrage entre Rennes et Vitré (à l’endroit du péage, lorsque l’autoroute devient payante) ils auraient pu affamer Paris en 4 à 5 jours. Et cela reprend l’idée très largement répandue ici, que la Bretagne nourrit la France, et contribue à nourrir le monde. C’est l’un des points de vue que j’ai approfondi dans mes recherches sur les marées vertes, car par exemple, la pollution qui est due à l’agriculture intensive est perçue ici comme un service que l’on rend aux autres : « Les autres mangent ce que l’on produit, et nous ici, on se retrouve avec un environnement dégradé ».
Klima : Tu voudrais dire qu’il y aurait une idée de sacrifice quand on pollue son propre environnement pour nourrir les autres ?
AL : Oui, c’était une façon de dire : « arrêtez l’agri-bashing ». Ce n’est que l’avatar le plus récent de tous les sacrifices que les agriculteurs ont dû faire pour rentrer dans ce modèle agricole qui a été, sur le plan social, très dévastateur. La Bretagne a perdu une grande partie de sa population agricole et les conditions de travail, notamment celles des éleveurs, se sont beaucoup dégradées. Même si, à certaines périodes, sur le plan du revenu cela a pu permettre à un grand nombre de familles d’accéder à un niveau de vie plus important, ce n’est plus le cas depuis longtemps, notamment en production laitière. Un couple d’éleveurs laitiers va gagner entre 15.000 euros et 20.000 euros par an pour deux personnes. Ça donne une idée de la tension qui peut exister, et pour ces agriculteurs-là, on comprend la difficulté pour eux d’accepter un droit de regard plus fort de la société sur leurs pratiques. Et pourtant, ça ne veut aucunement dire, et c’est là toute la difficulté, qu’ils ne sont pas eux-mêmes concernés par un certain nombre d’inquiétudes environnementales et qu’ils ne souhaitent pas améliorer la situation sur ce registre-là.

Klima : Est-ce que la problématique de l’adaptation aux changements climatiques est déjà présente pour les agriculteurs ?
AL : J’ai tendance à penser que le changement climatique, ou « dérèglement » climatique car cela a plus de sens lorsqu’on parle d’agriculture, est en fait un méta-problème environnemental. Méta, c’est-à-dire un problème à propos des problèmes, ou un problème qui entoure les autres problèmes.
Les agriculteurs suivent de près ces changements sur les territoires concernés. Globalement, le risque climatique, c’est pour eux une donnée avec laquelle ils composent en permanence. Les adaptations de systèmes et de conduite d’exploitation au regard des observations de terrain et du climat sont des processus permanents en agriculture.
La recherche de la modernisation et de la mécanisation a permis d’alléger la charge de travail physique, mais elle a permis aussi de s’affranchir de certains risques climatiques, c’est-à-dire d’assurer une garantie d’un certain volume de production avec un maximum d’autonomie sur l’exploitation, comme avec la culture du maïs.
Mais les problèmes environnementaux ne datent pas d’hier, et ils ont déjà conduit à repenser ce rapport à l’affranchissement de la contrainte climatique. Le risque climatique est en train de changer, et cet élément de changement global peut être l’un des paramètres que les agriculteurs prennent en compte dans l’évolution de leur exploitation.
Cela peut conduire à des stratégies d’adaptation extrêmement différenciées. L’une d’elle peut être de vouloir décoller le plus possible la production agricole de cet environnement devenu de plus en plus incertain, comme par exemple la production hors-sol. A contrario, d’autres vont essayer de reconstruire un lien au sol. Une expertise se développe pour analyser ces événements climatiques et adapter leurs pratiques à ces changements, partant du principe qu’ils doivent composer avec.
Certains, encore, vont se dire que le changement climatique va leur être favorable. Il fait plus chaud, les récoltes sont plus précoces, changeant le raisonnement sur les rotations, les assolements, etc. Cette année, par exemple, la récolte du maïs s’est faite très tôt, avec trois semaines d’écart avec ce qu’on peut observer d’habitude, et c’est vrai pour plein d’autres cultures. Il y a certaines cultures que l’on n’osait pas faire et que l’on peut faire maintenant. De plus, le risque de sécheresse est moins important ici que dans plein d’autres régions françaises. Donc, face à l’incertitude, il y existe des stratégies extrêmement différenciées. La seule chose dont je suis certaine, c’est que ces stratégies d’adaptation se déploient déjà.
Klima : Peux-tu nous parler des effets cumulatifs du changement climatique sur l’agriculture ?
AL : On pense souvent l’agriculture par rapport à sa dépendance au milieu, puisque c’est une activité de transformation des milieux. Cette dimension-là est évidemment présente, mais c’est aussi une activité sociale. En la regardant sous ces deux angles, on se rend compte que c’est autant la façon dont les interactions sociales localisées vont évoluer, sous l’influence notamment du dérèglement climatique, que la façon dont les milieux physiques vont évoluer, c’est la combinaison de ces deux paramètres qui vont influencer l’agriculture. Si les sociétés dans leur ensemble sont affectées par le dérèglement climatique, les comportements vis à vis de l’agriculture, de l’acquisition de terres, de la production alimentaire vont changer aussi.
Donc, les changements ne sont pas uniquement des agriculteurs pour l’agriculture de façon isolée, ils comprennent tout ce qui se passe sur le reste du territoire et ailleurs. Ça veut dire que cela produit une forme d’attention nouvelle à la production alimentaire sur des territoires à l’échelle locale.
Par exemple, aujourd’hui, il y a énormément de collectivités locales qui se disent qu’il est peut-être temps de remettre en place des politiques agricoles locales axées sur la production alimentaire de proximité. Ou bien, le souhait pour les habitants d’un territoire de s’intéresser à l’autonomie alimentaire, à l’échelle du foyer, mais aussi à l’échelle de leurs territoires de vie. Aujourd’hui certaines personnes décident de s’installer quelque part en fonction de ce critère-là, en se disant qu’ils veulent vivre dans un territoire où il y a un avenir pas trop dégradé qui se prépare. On commence à déceler de petits mouvements comme celui-la.
Klima : Et selon toi, ou alors selon les propos que tu as pu recueillir, quels sont les besoins des agriculteurs pour s’adapter sur le temps long ?
AL : Pour moi, la vraie question, c’est : « Ont-ils besoin d’être accompagnés ? Le souhaitent-ils ? ». On pourrait complètement inverser le raisonnement. Comment les agriculteurs peuvent-ils nous aider pour penser ce changement et nous accompagner nous autre non-agriculteurs ? Il faut penser de façon réciproque. Ils ont davantage besoin de solidarité et d’aide, au sens très concret du terme, plutôt que d’accompagnement et de conseil. Et c’est peut-être ça aussi qui permet une approche sociale de l’agriculture. Si on ne part pas du principe que les agriculteurs sont moins sensibles que d’autres couches de la population aux questions environnementales, mais qu’ils sont pris dans des itinéraires techniques qui laissent peu de marge de manœuvre. La vraie question, c’est : « Est-ce que les agriculteurs vont se dire qu’ils sont soutenus localement ? ». Est-ce qu’ils vont se dire « Oui, j’ai de la solidarité qui me permet de sortir de cet itinéraire technique ? Et si j’ai d’autres envies, elles auront une chance d’aboutir, j’ai une chance de m’en sortir avec un autre modèle parce que j’ai du soutien, parce que j’ai de la solidarité… »
Klima : Si l’on replace notre discours à l’échelle du bassin versant, d’après toi, quelles sont les connexions possibles entre le littoral et l’intérieur des terres ?
AL : J’aimerais parler de connexion et de reconstruction, à la fois sur le plan cognitif et sur le plan de l’action, afin de créer des connexions entre terre et mer par le rapprochement du travail de culture en mer (ramassage de coquillages, ostréiculture, conchyliculture…) pour reconnecter ces activités-là avec ce qui se passe sur les bassins versants. Car en fait, la gestion de l’eau est un élément très structurant pour une société donnée. Les infrastructures aquatiques créent de la solidarité entre les gens de l’amont et les gens de l’aval. Aujourd’hui, la mer n’est plus perçue comme un espace à part il y a une continuité qui se recrée. L’un des enjeux actuels, c’est d’arriver à penser globalement l’eau, non seulement en termes quantitatifs, mais aussi qualitatifs.
L’interdépendance des activités est très manifeste, comme celle entre l’ostréiculture en aval, et l’agriculture en amont. Par exemple, pour travailler sur la question de la fertilité des zones côtières, les activités ostréicoles et conchylicoles dépendent des apports nutritifs en provenance de la terre, mais ils doivent faire face à des milieux très changeants et à des apports excessifs qui fragilisent les espèces collectées ou cultivées. Donc ces incertitudes, ces équilibres fragiles, cette reconnexion-là peut être très porteuse. Si l’on arrive à reconnecter ces activités, si l’on repense la relation terre-mer à partir de l’activité productive, on pourrait changer beaucoup de choses.
Cela me rappelle le livre La forêt amante de la mer, qui raconte l’histoire d’un ostréiculteur japonais qui a réinvesti l’espace amont du bassin versant en pensant les relations que peuvent avoir les forêts en amont, son activité ostréicole et la santé de ses huîtres. Il y a ici dans le Finistère, à Daoulas, un homme qui se définit comme « paysan pêcheur » et dont l’approche est très similaire de celle du japonais. C’est un pêcheur qui s’est installé sur une ferme à proximité de la mer et qui a créé une série de projets destinés à modifier l’usage des terres, à recréer de la solidarité au sein des communautés locales avec l’alimentation et également des solidarités entre pêcheurs et agriculteurs.
Après, on reste sur des niveaux très « macro » qui demandent un réel engagement, qui est plutôt de l’ordre de la trajectoire de vie, cela ressemble souvent à des quêtes philosophiques et spirituelles. Et ça, c’est vraiment quelque chose qui doit nous pousser à réfléchir, car le temps long, c’est aussi la lenteur, ce n’est pas que l’urgence.
Klima : Oui, nous ressentons ça aussi dans notre propre quête et enquête, alors, d’après toi, comment peut-on concilier le temps long face à l’urgence ?
AL : Sur le plan anthropologique, il y a des personnes qui ont travaillé sur ce sujet, comme Hartmut Rosa, c’est-à-dire que la dégradation de l’environnement va à un tel rythme que l’on est pressé par un sentiment d’urgence. Mais pour faire face à l’urgence, il faut retrouver de la lenteur. La lenteur, c’est l’acceptation de ce qui est tel que c’est. C’est l’acceptation de l’état de dégradation dans lequel nous sommes, sans que cette acceptation soit une résignation. Et c’est cette tension-là que chacun vit, je pense intérieurement, dans le contexte dans lequel on évolue. C’est le fait d’être à la fois plus tolérant, plus dans l’acceptation des choses telles qu’elles sont et en même temps dans la mobilisation et la concentration des énergies vers le changement.
AL : Les personnes qui sont allées le plus loin dans leur démarche, que ce soit côté mer ou côté terre, sont des personnes qui sont retournées vers les livres, vers une forme de philosophie de l’environnement qui leur permet d’accepter une évolution de leurs conditions de vie, une précarité matérielle, une capacité à entendre le point de vue de l’autre et à admettre qu’il n’est pas au même point que le nôtre. Il faut éviter cette précipitation oppressante qui consiste à dire « Le monde brûle, la maison brûle ». À l’échelle institutionnelle, il est fondamental que les priorités changent. À l’échelle individuelle, il faut changer les comportements, mais changer les comportements ce n’est pas seulement acheter plus écolo, c’est aussi retourner vers la pensée, retourner vers son rythme et retourner vers la lecture. En fait, c’est très personnel, très intime, donc cela demande d’être attentif à cette temporalité multiple.
Klima : La lecture, mais peut-être aussi le partage de ce qu’on ressent, de ce que l’on voit, ce que l’on observe, de nos réflexions…
AL : Oui, effectivement, pour moi, cela relève exactement du même processus. Parce qu’en fait, cela relève de la nourriture intérieure, c’est ça qui donne de la ressource pour aller vers les autres, car si l’on n’est pas nourri intérieurement alors on n’a pas envie de se confronter, de s’exposer à de la critique, à du débat, à de la contradiction. Mais si tu es nourri intérieurement, tu peux y aller sans crainte. Ça va un peu ensemble pour moi, mais peut-être qu’on s’éloigne un petit peu…
Klima : Non, au contraire, c’est très porteur ce que tu viens de dire, ça résonne avec de nombreuses questions qui nous habitent et que l’on se pose tout le temps, comme la question du temps, celle de l’engagement, ou celle de la difficulté de changer nos façons de faire…
Klima : Avant de terminer nous avons trois petites questions bonus. Alors, en temps difficiles quel serait ton territoire refuge ou ton lieu refuge ?
AL : C’est Rosnoën, c’est un refuge pour moi. Mais je ne vois pas l’avenir comme étant plus difficile que maintenant parce que j’ai l’impression que toutes ces temporalités elles se mélangent déjà dans nos esprits. Et j’ai essayé quand je me suis installée ici, de considérer en quoi le fait de s’installer quelque part pouvait devenir une ressource pour moi bien sûr, mais aussi pour tous ceux qui m’entourent. Et donc j’ai imaginé ce lieu comme un endroit où je pourrais accueillir des gens. Évidemment, je ne pensais pas à une apocalypse environnementale particulièrement, mais ça fait partie des lieux que j’aime parce que l’on peut aussi y recréer du lien, du rapport aux mondes plus qu’humain, il y a de l’eau, il y a la mer, il y a la perspective. Et voilà, je m’y sens bien.
Klima : Alors, en parlant du monde plus qu’humain, justement nous avons deux questions à ce sujet : si tu étais une langoustine et si tu avais des antennes de langoustine, tu aimerais capter quoi ?
AL : J’aimerais bien capter la respiration du monde, tout ce qui est infra-sonore. Parfois, j’envie les plantes et les animaux pour leurs capacités à capter le monde qui nous entoure…
Klima : Et si tu étais un autre être vivant qui peuple notre terre, que ce soit un animal, un végétal ou un rocher, lequel choisirais-tu et pourquoi ?
AL : Je serais une loutre ! J’ai la chance de vivre dans un village où il y a une loutre qui s’est installée il y a pas très longtemps. Je suis allée très discrètement regarder où elle s’était installée et c’est pas mal. La loutre a une zone de chasse sur un territoire assez large, je crois qu’il lui faut au moins huit kilomètres de littoral, de terre, de zone de pêche. J’aimerais bien avoir la possibilité, comme elle, de me balader dans ma grosse fourrure dans l’estuaire par tous les temps, manger du bon poisson frais, ça m’irait bien…
Klima : Merci beaucoup Alix pour ce temps de discussion, nous sommes vraiment très heureuses d’avoir pu aborder tous ces sujets avec toi.
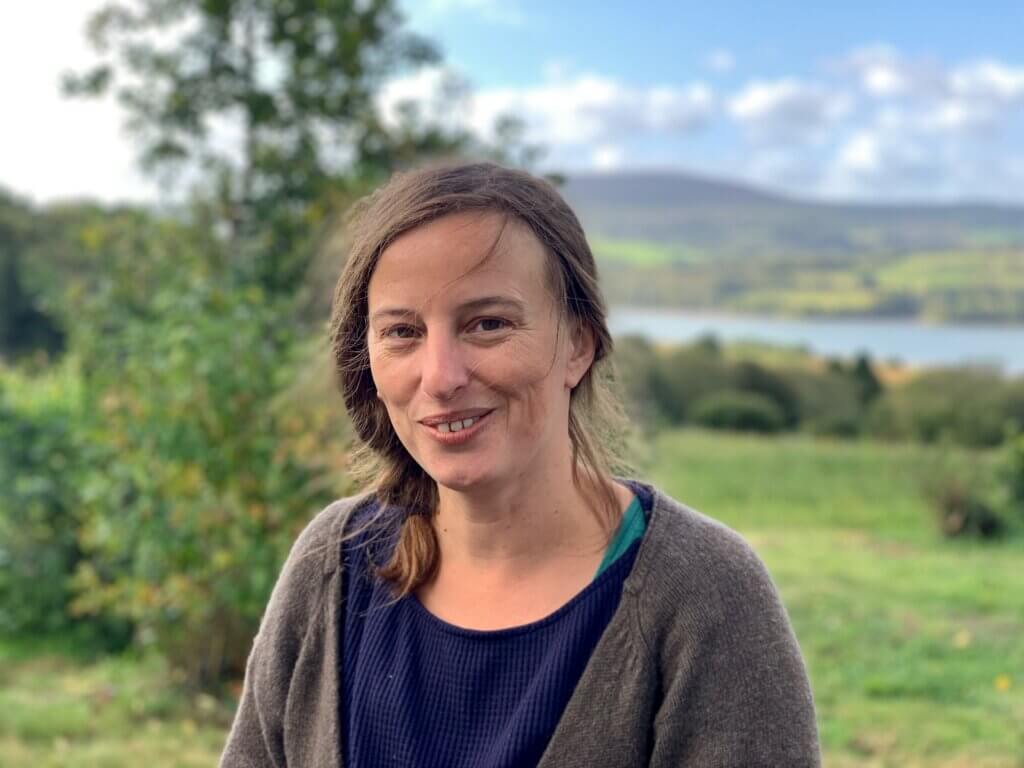


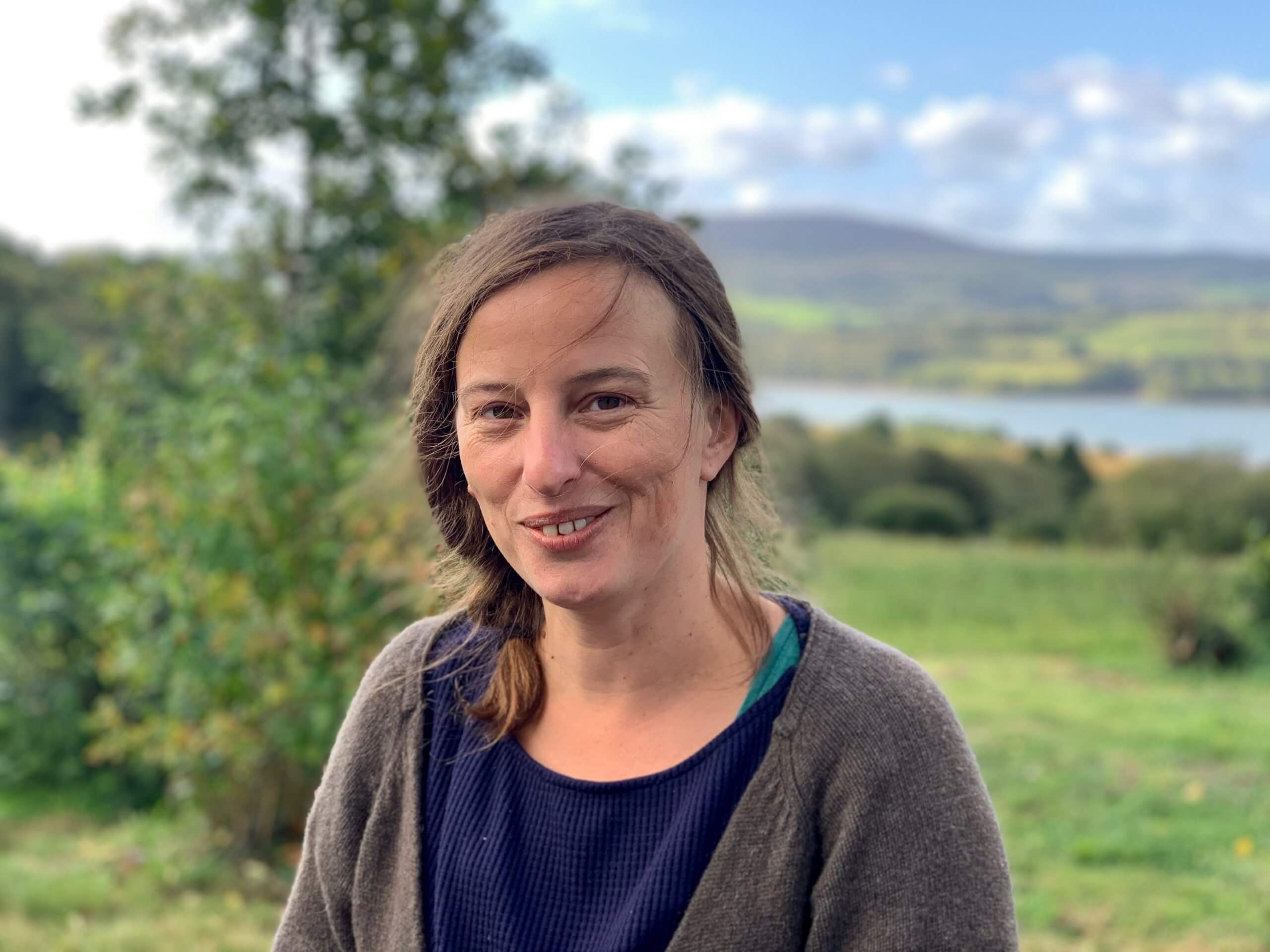
 Retour aux productions
Retour aux productions
